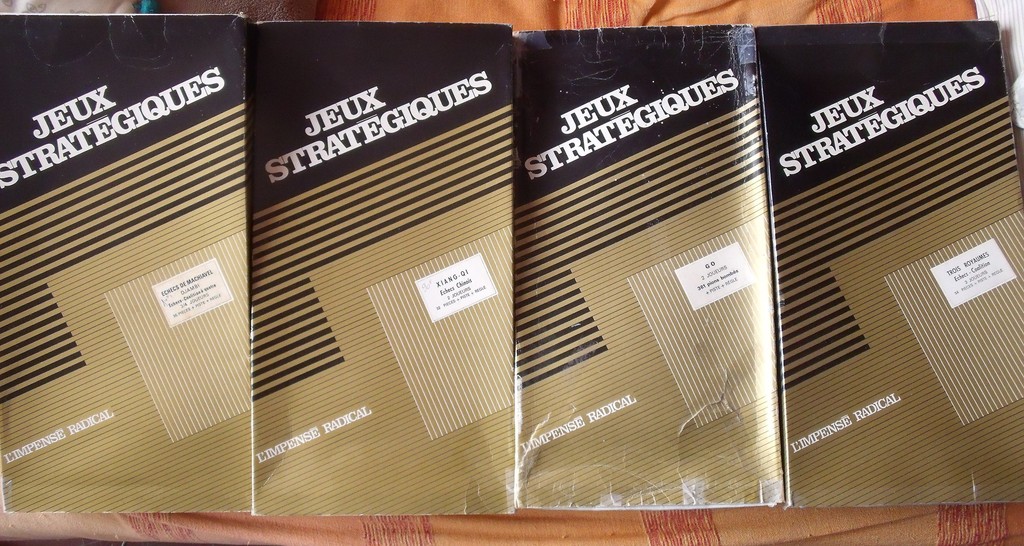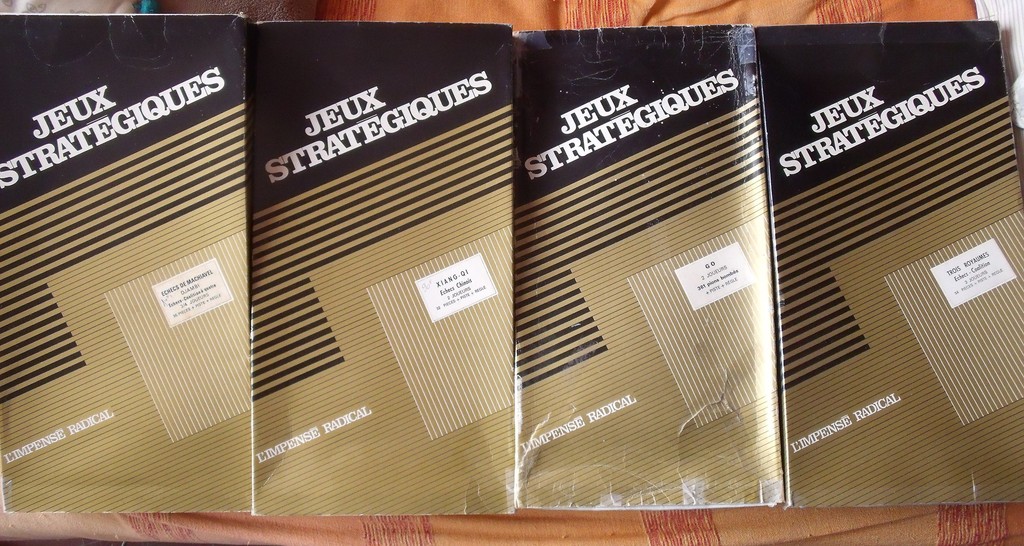
Les nouveaux ancêtres
Une conversation avec McKenzie Wark
Gean Moreno : Il semble que les survivants de l’étrange hallucination qu’on avait appelée la Fin de l’Histoire reprennent audacieusement la parole, de l’extérieur — l’extérieur de la disposition socio-économique existante, l’extérieur des formes existantes de la vie quotidienne, l’extérieur de l’autorité du discours institutionnel. C’est en relation avec la réaffirmation de cette figure — ou trope, — l’extérieur, que j’ai lu votre contribution dans
Excommunication : trois enquêtes dans les médias et la médiation [
1], et en particulier votre introduction sur le concept de xéno-communication, une sorte de statut des lignes d’échange avec l’altérité. Ce qui est également intéressant dans la notion de xéno-communication elle-même, c’est que sa possibilité génère une compétition administrative pour le contrôle du portail. Quelqu’un doit patrouiller aux points de contact. Et les vainqueurs de la course furent généralement des formes de pouvoir épouvantables, telles l’Église ou la dictature du Parti. Dans ce que vous écrivez, je devine la suggestion latente qu’en ce moment il n’y ait pas de patrouille des frontières crédible pour réguler les contacts avec l’extérieur. Et cela confère à notre moment une des possibilités pouvant être faite avec ces portails.
McKenzie Wark : C’est peut être parce qu’en troisième génération d’athées je viens d’une culture protestante. Nous ne tenons pas en affection les autorités qui prétendent se faire accorder des droits exclusifs de l’autre pour en être ses représentants — qu’ils soient les fratries divines ou lacaniennes.
En effet, dans le livre Excommunication co-écrit avec Alex Galloway et Eugene Thacker, ma partie est à propos de la xéno-communication, dans le double sens de la communication avec ce qui est étrange et aussi une certaine hospitalité envers ce qui est étranger. Je voulais proposer, de façon spéculative, que la communication semblât s’épanouir sous une sorte de permission conditionnelle, inhérente à la xéno-communication — communication avec ce qui, dans un sens, n’est pas là ou ne peut pas être là. Mais plutôt que Saint-Paul, j’ai voulu suivre le chemin des hérétiques et des dissidents qui refusaient de respecter les voies autorisées de la xéno-communication, sans parler du maintien de l’ordre à leur égard, car ce que Paul faisait était comparable à la NSA de la xéno-communication. Donc, j’ai esquissé une petite contre-histoire pour les contrôleurs judéo-chrétiens des portails de la xéno-communication. Cette contre-histoire inclut les sectes hérétiques tels les Babelites et les descendants modernes des hérétiques comme Charles Fourier, Raoul Vaneigem, et François Laruelle.
D’ailleurs Laruelle pourrait être interprété d’une façon étonnamment protestante. Il n’y a rien à faire pour gagner la Grâce. La xéno-communication est tout entière dans une direction. L’autre peut en effet communiquer avec nous, d’une certaine façon, mais il n’y a pas de réciprocité, pas d’échange. Ou encore vous pouvez le comprendre à travers Épicure et Lucrèce : certes, les dieux existent, mais ils ne remarquent pas que nous existons. Cette idée peut être plus libératrice que l’idée que Dieu soit mort, qui n’éclaircit l’espace que pour l’homme prenant sa place comme le corrélat de la nature. Peut-être que nous ferions mieux de construire l’espace de la pensée autour de la notion que l’Un est unilatéral, qu’il n’y a pas d’échange et donc que personne ne peut être l’agent des droits exclusifs.
GM : Est-ce l’une des possibilités offertes par la conception de l’Un unilatéral chez Laruelle [
2] selon laquelle l’extérieur, ce qui est autre pour nous, est maintenant en quelque sorte à l’intérieur, à l’intérieur de la totalité sociale elle-même ? Il n’y a pas nulle part où aller le chercher.
MW : Oui, qu’on ait pu l’appeler, l’extérieur, l’étranger, l’altérité, — ce n’est jamais loin. Disons, ce que Tim Morton qualifie de "maillage" [
3] en fait ce n’est pas un grand autre [
4]. C’est très difficile à saisir, car cela a à voir avec la façon dont les choses ne sont pas parfaitement imbriquées dans une hiérarchie des échelles, des grandes aux petites, bien que passant par une tranche d’échelles moyennes que l’humain peut comprendre. On n’a pas vraiment besoin d’un spécialiste pour surveiller le portail à l’absolu de notre défense, comme si elle était à une plus grande échelle que celle pouvant être appréhendée par une personne de rang supérieur.
La chose étrange est que nous croyions que la xéno-communication doive avoir une condition limite, afin de mettre une borne à l’intérieur de laquelle la communication de façon régulière à propos des échelles régulières puisse se poursuivre. Mais il n’y a personne qui puisse actuellement justifier la xéno-communication comme un droit spécial. De façon intéressante, la philosophie est allée dans quelques directions pour tenter cela. L’une est réactionnaire : un retour au langage religieux. L’autre est plus ingénieuse, et repose, par exemple, sur une allégation que les mathématiques soient de l’ontologie. Ce qui n’est pas une reprise de la religion, mais de Pythagore.
Un vide théologique ou une ontologie mathématique pourraient nous donner une ressource intéressante pour parler de l’absolu, et cela pourrait être amusant et profond et peut-être même convaincant. Mais ce n’est pas nécessaire. L’absolu pour rencontrer son objet de pensée n’a pas de moyens réciproques réglables, répétés. C’est l’absolu comme fétiche. D’autre part, les sciences naturelles fournissent parfois une connaissance des choses inhumaines, sinon entièrement non humaines. Pendant longtemps, les sciences ont procédé par l’intermédiaire d’un appareil, une série de techniques. La science est une sorte de média, une communication avec des choses inhumaines. La science nous permet de lire au-delà, pour ainsi dire, des signes d’un monde tout à fait indifférent à nous, mais d’une manière qui a une sorte limitée de réciprocité et d’itération. Vous pouvez tester les résultats, les ajuster, même les améliorer. Les prétentions de la théologie et de la philosophie pour en quelque sorte l’excéder, ou le réglementer ou légiférer pour ça, sont clairement ridicules. Mais bizarrement, ces revendications sont de retour.
Je pense qu’une approche plus modeste s’impose, une sorte de basse théorie, qui ne soit rien de plus qu’une langue créole pour négocier différents modes de vie et la production des connaissances. Sauf que je ne pense pas que nous puissions parler désormais des vertus de la tactique, du marginal, du local, du différent, et ainsi de suite. Les petites choses ne vont pas nous sauver des grandes choses. C’est davantage la question de se rendre compte que tout simplement cette hiérarchie des échelles n’existe pas. La pensée est allée depuis penser la différence jusqu’à penser l’universalité, comme si celles-ci correspondaient à différentes échelles, à la petite et à la grande. Ce qui n’est pas le cas. Les atomes de carbone et la biosphère communiquent directement. Nous vivons dans une ère de la pensée sur la façon dont les petites choses sont simultanément de grandes choses, en particulier dans un tel monde intensivement en réseau. Nous avons tendance à penser local/ global, différent/ semblable, et petit/ grand comme des concepts qui s’effondreraient l’un sur l’autre. Au lieu de cela, il est temps de penser le maillage libre d’échelle.
GM : Comment peut-on travailler au sein du maillage sans échelle ? Si le but est d’arrêter la reproduction du monde tel qu’il est, s’il n’y a plus de corrélation entre l’artefact (culturel, religieux, etc.) et une version de l’absolu, si l’utopie en tant que promesse et sorte d’anticipation ne peut plus être capturée en aucune façon productive dans l’objet qui prend sa place, ni même un petit coup de pouce pour l’actualiser : où peut-on investir l’énergie et les ressources ? Bien que dans Excommunication vous employiez l’infrastructure comme une métaphore du Réel ou de l’Unique, je veux dire intuitivement que les infrastructures — les infrastructures en béton, ou les réseaux par lesquels les ressources sont distribuées et à travers lesquels « petit » et « grand » communiquent directement (et annulent cette hiérarchie des échelles) — sont de bons endroits d’intervention et d’inflexion. Cette intuition figure en quoi je comprends certaines des plaintes que vous avez exprimées au sujet de l’inefficacité de l’art contemporain.
MW : C’est intéressant de voir par ailleurs comment des théories critiques de l’esthétique très différentes se sont toutes retrouvées au même endroit. D’après Adorno, vous pourriez penser de l’œuvre d’art comme d’une véritable non-équivalence, comme ce qui refuse la réconciliation extorquée de la valeur d’échange. D’après Althusser, vous pourriez penser l’art dans le cadre d’un domaine super-structurel spécialisé, doté d’une autonomie relative par rapport aux luttes infra-structurelles. D’après Rancière, vous pourriez assimiler l’esthétique au politique, de sorte que tout acte esthétique, s’il redistribue le sensible, comprend le politique en même temps, en quelque sorte magiquement. Ou vous pourriez emprunter la voie postcoloniale et voir les représentations de l’autre comme ayant une fonction de pouvoir spécial dans le besoin de déconstruction, au sens le plus large du mot.
Tout cela, d’ailleurs, avait tendance à être fondé sur une sorte d’échange ou de relation structurelle entre l’infrastructure et la superstructure. C’était une reproduction, dans un langage social quasi-marxiste, de la vieille corrélation sujet / objet. Mais que faire dès lors que premièrement nous ne savons jamais vraiment à l’avance ce qui est infrastructure et ce qui est superstructure ? Le découpage à l’avance de l’ensemble social, en tant qu’a priori conceptuel chez Althusser, est simplement un non-sens complet. Et deuxièmement que se passe-t-il si l’infrastructure et la superstructure ne sont en aucune façon des instances équivalentes ou comparables dans la formation sociale ? Ce qui importe à propos de l’infrastructure, c’est que ce soit la base, dans tous les sens du qualificatif — basique mais aussi malpropre, dégoûtant, primitif, — d’une rencontre par l’intermédiaire d’un appareil avec quelque chose de tout à fait inhumain.
C’est pourquoi je m’intéresse à ces théories critiques et à ces avant-gardes qui ont vraiment puisé de différentes façons dans la question triviale de la base : à partir de Alexander Bogdanov, Boris Arvatov, Andrei Platonov, et les diverses formes du Proletkoult soviétique dans les années vingt, jusqu’à l’économie générale de Georges Bataille et les pratiques situationnistes du potlatch et du détournement. Ces choses ont été modestes dans leurs effets, mais étaient vraiment les prototypes de nouvelles sortes d’esthétiques de l’économie et de la technologie. Incidemment, c’est aussi ce qui concerne Walter Benjamin — dans une lecture succincte : son intérêt dans l’appareil du cinéma comme une sorte de perception inhumaine, et la reproduction mécanique comme un coup porté à une certaine forme de relation de propriété dans l’esthétique. Ou pour faire court : l’art doit être basique et de mauvais goût ou rien du tout.
GM : Être basique et vulgaire, à considérer les exemples que vous offrez — en supposant la condition du modèle initial d’une relation (plutôt que d’un objet), — est l’espace le plus productif trouvé pour l’art dans le domaine social ? Il semble y avoir ici une critique implicite, à la fois de l’institution de l’art et de l’obsession actuelle en matière de pratique de l’art, et de la théorie quant à l’auto-référence et la spécificité des médias.
MW : Si l’on a quelque connaissance du monde actuel, comment réagir aux dominantes du monde de l’art en cours avec n’importe quoi d’autre que l’ennui ? Non qu’il n’y ait pas de contre-courants et de poches intéressantes, mais le monde de l’art capital avec un grand A est précisément la décoration. De l’IKEA pour milliardaires. C’est juste sans intérêt pour quiconque n’étant pas accordé à y prêter attention. C’est pourquoi je trouve que le design et l’architecture sont les domaines les plus intéressants, où les gens ne sont pas simplement à essayer de faire un prototype des relations sociales, mais aussi des relations asociales, c’est à dire, les questions d’infrastructures, de l’inhumain, et ainsi de suite. Ce sont des champs qui ne jouent pas seulement dans leur champ spécifique, leurs jeux auto-référentiels.
D’autre part, n’y a-t-il pas encore un potentiel formidable dans les ressources de l’art ? Que faire si nous avons tourné le tout à l’envers ? Que faire si nous avons mis la main à la fois sur le Monde de l’Art et ce que Greg Sholette appelle la « matière noire » de l’art [
5], tous ces enseignants et étudiants d’art et les peintres du dimanche, et traité le tout comme des ressources potentielles pour des expériences dans un autre mode de vie ? Ce pourrait être une question d’avant-garde d’un genre à la mode plus vieux, on n’est pas conçu à l’avance pour être leader de tendance dans le Monde de l’Art. Une qui avait vraiment essayé d’abolir et de remplacer l’art que nous connaissons. Ne serait-ce pas amusant ?
Asger Jorn pensait que le problème avec le monde moderne était la division entre le travail, qui conditionne le contenu dans les formes, la conception, qui crée des formes de contenu, et l’art, devenu une sorte de contenu sans forme. Il voulait combler le fossé, et même abolir la relation de marchandisation dans laquelle les formes ne font que retenir les contenus, — comme les boîtes contiennent la soupe — en sorte qu’ils puissent être échangés et consommés [
6]. Ce serait le point que Chiara Bottici qualifie d’« imaginal » [
7], qui est un peu ce que Castoriadis appelle «
L’institution imaginaire de la société » [
8] : une pratique en collaboration collective de création de nouvelles formes qui ne sont pas purement formelles, mais qui sont des propositions pour des formes de vie. L’art, qui fait toujours ce qui dans l’art m’intéresse encore.
GM : L’autre chose où nous devrions nous immerger davantage est la relation entre les sciences naturelles et l’inhumain. C’est particulièrement intéressant par rapport à ce que Benjamin Bratton appelle le « post-anthropocène » [
9] le moment où nous, nos formats biologiques ainsi que certains horizons technologiques et politiques serons déphasés, refonte telle la version bêta — et nous concernant — de la nouvelle formation de l’étranger.
MW : Les sciences naturelles sont la connaissance de l’étranger. La façon dont cela éclate de la corrélation du sujet connaissant et connaissable, l’objet phénoménal, passe par une troisième chose : l’appareil. L’appareil est un assemblage de technologie et de main-d’œuvre qui enregistre et mesure les perceptions de ce qui est inhumain et qui médiatise les effets retour de ces perceptions sur l’humain, secondairement — comme un contre-coup. Voilà pourquoi, d’ailleurs, il ne peut plus y avoir aucune philosophie des sciences, mais seulement une théorie des médias.
Prenez la science du climat — une clé de notre temps. Elle repose sur un appareil d’ordinateurs très puissants et des vecteurs de communication qui surmontent les « frictions » — comme les appelle Paul Edwards — entre les données et la communication [
10]. Elle rassemble des données globales selon les normes mondiales, des modèles mathématiques de la physique du climat tirés de la dynamique des fluides, et une puissance de calcul énorme. Le modèle et les données se co-produisent en sorte que les ensembles de données sont tous partiels et que beaucoup de points de données doivent être interpolés pour faire fonctionner les modèles. Puis tout cela doit être négocié en revenant à la conscience humaine via des tables, des graphiques, des simulations informatiques, et ainsi de suite [
11].
Même notre capacité de connaître la physique et la chimie basiques de la biosphère et de prédire le résultat de leur ajouter des quantités massives de carbone est très récente, peut-être depuis trente ans seulement. Mais généralement le dispositif n’est pas nouveau, et peut-être même pas propre à notre espèce. Notre espèce a toujours perçu le monde via un appareil. Nous avons mesuré le temps en recourant à des marques sur un bâton ou sur un rocher, peut-être dès le début. Il n’y a jamais eu un moment où nous n’avons pas disposé d’outils. Nous éprouvons le bois ou la pierre ou la terre grâce à des outils qui coupent et creusent. Nous avons toujours connu le monde via un appareil inhumain de travail et de technologie. Il n’y a jamais eu un être humain sans l’inhumain.
Maintenant, il est en question de savoir si l’infrastructure de l’appareil inhumain/humain, avec ses tentacules profondes dans la matière de base, peut être un moyen pour produire une version qualitativement différente d’elle-même. Ce que j’entends Ben Bratton demander [
12] est ceci : cette infrastructure peut-elle en produire une autre ? Peut-on modifier les moyens de production ? Non pas tant par une « révolution » — qui n’est généralement rien de plus qu’un phénomène super-structurel — mais une mutation. Une mutation dans les outils et à la fois des relations, des économies, des affects, et ainsi de suite. Notre travail est vraiment de modéliser les composantes d’un nouveau mode de production.
GM : D’une certaine manière nous nous en remettons à un extérieur sécularisé, l’autre qui est déjà là, attendant d’être extrait, non pas par xéno-communication mais par bricolage, à travers des expériences qui induisent une mutation. La science, pour le moment, est peut-être l’endroit pour chercher des connaissances de l’étranger, mais il semble que la conception [le design] — avec sa liberté quasi-artistique et son penchant pour la modélisation spéculative — est éventuellement l’endroit où de nouveaux appareils peuvent être générés et à travers lesquels des infrastructures peuvent être testées par rapport à la porosité et la flexibilité [
13].
MW : Oui, je trouve que le design, ou les régions frontalières entre le design, l’art, l’architecture et la technologie, sont une zone intéressante. Il faut dire que ça ne peut pas être un âge d’or pour la science et la technologie. On nous dit constamment que nous vivons dans une ère de « bouleversement » et d’ « innovation », en réalité nous pensons que c’est tout à fait l’inverse. C’est une époque du semblable incessant de la marchandisation. Sauf que pour concevoir à travers l’ensemble du spectre allant des sciences à la technologie, il y a beaucoup de personnes qui veulent plus que cela et qui travaillent activement en dehors de ce cadre. Un des grands défis de l’époque est de reconnecter les énergies imaginales dans les sciences à celles dans les sciences humaines, et quelque chose comme la conception est peut-être un bon point de rencontre pour mettre à l’ouvrage cette issue. Comme l’affirme Anne Balsamo ma collègue de New School, il y a une imagination technologique, une construction culturelle, qui fixent certaines limites selon lesquelles les gens techno peuvent initier et organiser ces sortes de projets [
14]. Donc, en partie, c’est une question d’élargissement de l’imagination technologique.
J’ai commis quelques modestes travaux qui résident dans cet espace. Par exemple, la version du livre en réseau de
Théorie du Joueur [
15] était une façon d’imaginer à quoi le travail collaboratif d’écriture pouvait ressembler. Ou le projet #3Debord, dans le cadre duquel nous avons fait des figurines de Guy Debord imprimées en 3D [
16]. C’était une façon de poser des questions sur les deux concepts-clés de la recherche de Debord : spectacle et détournement. Que signifie de se déplacer au-delà du monde des images vers le monde des choses à la fois dans le spectacle et le détournement ? Que l’on pût faire de Debord lui-même un fichier libre en .stl, importuna des gens — je crois. Était-ce une marchandise ? Peut-être, mais elle n’était pas à vendre et le fichier était gratuit. Chacun peut en faire un, ou en modifier un. Ainsi quel genre d’objet est-ce ? Cela peut procurer des exemples mineurs de ce qu’on pourrait appeler le design conceptuel. Ce n’est probablement en rien une grande avancée par rapport aux obsessions média-spécifiques et autoréférentielles du monde de l’art, mais cela concerne au moins les différents domaines de référence, et un média différent. Et c’est une recherche qui pourrait diriger vers l’externité [
17] plutôt que vers l’intériorité. Qu’est-ce c’est là-bas ? Quels genres de pratique, grappillant sur le pourtour d’un appareil, pourrait permettre de faire un petit pas au grand air ?
GM : Parlons de l’écriture — pas tant vos habitudes d’écriture que la vitesse à laquelle vous semblez sortir votre matériau, ni votre proximité avec différentes plateformes, et la façon dont vous employez souvent le même matériau dans de multiples contextes. Mais contrairement à certains des écrivains à propos desquels vous avez écrit, qui ont souvent favorisé l’auto-marginalisation, vous semblez intéressé par une sorte de diffusion constante et une forme non-académique d’échange public. Comment voyez-vous cela ?
MW : Quand on a demandé à Charlie Parker sa religion, il a répondu, « je suis un musicien dévot ». C’est la même chose avec moi — quoique revendiquant bien de ne pas me mettre au même niveau que Bird [
18]. Je suis un auteur dévot. C’est juste ce que je fais et à peu près quotidiennement. En tant qu’ancien journaliste je sais écrire rapidement. Comme Walter Benjamin l’a dit, je sais que « L’œuvre est le masque mortuaire de sa conception » [
19]. Ainsi à un certain point elle est faite et il est temps d’avancer.
Une chose venant d’un auteur qui baigne dans les modernes et les avant-gardes, c’est que je n’accepte tout simplement pas les conventions en matière d’études ou de journalisme. Je suis intéressé par toute la pratique relative à l’objet de la critique et de l’expérience, y compris les économies et les technologies. Et bien sûr je suis sur Facebook depuis vingt-cinq ans, je veux dire par là que je suis advenu par le système des bulletins électroniques [
20], les groupes Usenet, The WELL [
21], et en particulier la liste de serveur d’avant-garde Nettime.org. Aussi naturellement je suis intéressé par comment on travaille dans et contre les industries de la culture textuelle dominantes de notre temps. La seule façon que vous arriviez à écrire des livres — ce qui me plaît vraiment — est de créer le lectorat pour les lire.
Ce serait ma réponse d’écrivain. Mais je suis aussi un ancien militant, par conséquent j’ai un certain entraînement dans les modes d’adresse. Ces jours-ci, je suis plus intéressé par confondre que par persuader, aussi dans ce sens plutôt l’avant-garde que la pratique gagnée par le militantisme. Je pense que ma pratique consiste dans une certaine part du jeu d’écrire, c’est mieux.
GM : Bien que ces dernières années vous ayez consacré beaucoup de temps à l’Internationale situationniste, vous avez un nouveau projet en mouvement sur la culture post-révolutionnaire russe [
22]. En diriez-vous quelque chose ?
MW : Je pense que nous avons besoin de nouveaux ancêtres. Les vieux, dans l’art et la théorie, ont été épuisés et nous épuisent. De toutes façons on ne peut se constituer simplement du passé. Quand on fait trois pas en avant on en fait deux en arrière, pour autant je pense qu’il est temps de voir les archives davantage comme un labyrinthe de Borges plutôt qu’une origine, particulièrement du côté de la théorie. Donc je travaille sur une histoire alternée, à l’intersection de la théorie critique avec les avant-gardes au vingtième siècle. The Beach Beneath the Street et Spectacle of Disintegration sont les volumes d’une série supposés trois et quatre.
Molecular Red [
23], que je termine maintenant, est le premier volume. C’est à propos de Alexander Bogdanov, rival de Lénine pour la direction du Parti bolchevique et fondateur du Proletkoult. C’est également sur Andrei Platonov, le meilleur accomplissement de l’avant-garde Proletkoult. C’est une façon de tracer à travers un certain moment de la Révolution d’Octobre, un moment différent du moment trotskiste, qui ne cesse de demander encore et où tout a mal tourné. C’est également une alternative à ce qui est généralement considéré comme l’avant-garde des années vingt soviétiques, — les futuristes, les constructivistes, les formalistes ; dans ce récit, le Proletkoult est habituellement le grand absent, parce que ses pratiquants voulaient tellement plus qu’un style, — ils voulaient un mode de production dans la culture et la science entièrement nouveau.
Bref, j’ai passé un certain temps à montrer la richesse qui avait été tenue à l’écart. Nous n’avons pas besoin de continuer à citer le bordel de merde d’Heidegger [
24]. L’Art ne doit pas être les itérations infinies de la gestuelle de Duchamp. Nous n’avons pas à ranimer Lénine, comme si aucune autre pensée radicale n’avait existé. Je suis plutôt attiré par les hérétiques. Si nous devons avoir des ancêtres, que ce soit sans le nom du Père. Ayons des drôles de tantes et des oncles étranges. C’est beaucoup plus amusant, et peut-être même est-ce une façon de débloquer la stase de l’art contemporain et de la théorie — il faut bien admettre que ce fut un peu ennuyeux.
G.M. & M. W.
Traduction et annotations par Louise Desrenards pour Criticalsecret (mai 2015).
Source © 2014 e-flux and the author.

* Si le tweet qui apparaît dans la fenêtre d’envoi est trop long, (le nombre de signes en excès apparaissant dessous, précédé de : "-") le raccourcir avant de l’envoyer, en prenant soin de ne pas supprimer le lien même de l’article. / * If the content of the tweet is too long (the number of characters in excess is indicated by a negative value), please shorten it and make sure you do not crop the link.

- Les nouveaux ancêtres
- The Molecular Red
Reader
Sources compilées
par McKenzie Wark
(Verso Blogs)

 WWW.CRITICALSECRET.NET — - - —
WWW.CRITICALSECRET.NET — - - —